Cet billet a été publié en deux parties par le philosophe des sciences Massimo Pigliucci sur son blog Footnotes to Plato le 28 décembre 2018.
Quelle est la place de l’aspect social dans la fabrication de la science ? Si on regarde des manuels scientifiques, on se rend compte que la dimension sociale du savoir scientifique brille par son absence. La science reflète supposément le monde tel qu’il est réellement, indépendamment de nos petites vies respectives. D’un point de vue classique, il s’agit du summum de l’activité rationnelle, libre d’influences sociales. Bien sûr, la science est portée par des êtres humains, mais leur background et leur vie sociale sont simplement considérés comme non pertinents. Ce qui compte, ce sont les mérites intellectuels d’une théorie scientifique, et non pas qui a pu la concevoir. Ce qui compte, ce sont les preuves, et non pas qui a bien pu les collecter. Cette partition tranchée entre le social et le rationnel peut se retrouver en philosophie des sciences également. Étant donné que les facteurs sociaux sont invisibilisés dans le rendu final de la science, beaucoup de philosophes ont effectivement sous-estimé le rôle moteur de ces facteurs dans l’acquisition des connaissances scientifiques.
Ces dernières décennies, les sociologues et les historiens ont essayé de ramener la science sur terre, mais beaucoup d’entre eux s’en sont retrouvés amenés à une opposition tout aussi simpliste. Les influences sociales sur la science ont autant été un objet de délectation pour ses critiques les plus cyniques, qu’un repoussoir pour ses admirateurs, et ceci pour la même raison : la peur (ou l’espoir), que cela pourrait ruiner la crédibilité de la science. Dans un article que j’ai co-écrit avec mon complice habituel, Maarten Boudry (publié dans Perspectives in Science and Culture, edited by K. Rutten, S. Blancke, and R. Soetaert, Purdue University Press [1]), nous discutons des origines historiques de cette opposition qui a culminé dans le spectacle déplorable des science wars. Le présent billet constitue un résumé étendu de ce papier, et j’espère que vous l’apprécierez.
Quand est-ce que l’on ressent le besoin d’expliquer les raisons pour lesquelles quelqu’un croit quelque chose ? En effet, toutes les croyances tenues pour vraies par nos semblables ne semblent pas susciter une telle prudence épistémique. Les gens croient que les dauphins sont des mammifères, que la Terre tourne autour du Soleil, et que la deuxième guerre mondiale s’est terminée en 1945. Mais pour autant, nous demandons rarement comment ces personnes en sont venues à ces croyances. De telles croyances sont simplement tenues pour évidentes, et aucune personne saine ne penserait à les disputer. Ceci étant dit… qui vous a dit que la deuxième guerre mondiale s’était terminée en 1945 ? Où avez-vous obtenu cette croyance que les dauphins sont des mammifères ou que la Terre tourne autour du Soleil ? Vos sources pour de telles croyances sont difficiles à retrouver.
Le souvenir de ces faits est appelé mémoire sémantique par les psychologues, et se distingue ainsi de ce qu’on appelle la mémoire épisodique qui est elle associée aux souvenirs de choses qui nous sont arrivées. La mémoire épisodique est marquée par des instants et endroits précis, la situation durant laquelle ces souvenirs ont été acquis. Ce n’est pas le cas des souvenirs de la mémoire sémantique, probablement parce qu’une telle association serait un gâchis de ressources cérébrales.
Prenez la croyance selon laquelle le charbon est noir. Si vous demandez à quelqu’un quelles sont ses raisons pour tenir une telle croyance, cette personne sera probablement interloquée. La première réponse qui lui viendrait alors à l’esprit serait probablement du genre « Bah, parce que c’est noir évidement ! ». La manière dont vous avez acquis cette croyance au départ ne compte pas, alors que vous pourriez l’avoir acquise de multiples façons. Quiconque douterait de la couleur du charbon pourrait retrouver la réponse correcte par une multitude de sources.
Parce que la réalité de telles croyances est évidente, nous demandons rarement aux gens comment ils ont acquis ces croyances, ou comment ils peuvent les justifier. Tout se passe comme si elles étaient simplement apparues de nulle part, sans cause bien établie.
Ceci étant dit, comment rendons-nous compte d’autres types de croyances (tenues par les autres, et non par nous-même évidemment) ? Les croyances fausses, bizarres, particulières ou totalement irrationnelles appellent à une certaine prudence épistémique. Nous avons soudain la volonté d’expliquer comment des personnes en sont venues à embrasser de telles croyances. Qui a bien pu leur raconter un tel bullshit ? Sont-ils encore tombés sur l’une de ces théories conspirationnistes d’internet ?
Nous ne recourons à des explications spéciales que quand quelque chose est incorrect. Les croyances vraies, qui sont une partie de la connaissance commune, sont acceptées telles quelles, mais les croyances fausses et les croyances idiotes nécessitent une explication. C’est à ce moment seulement que les explications sociales et culturelles sont appelées. Cependant, de telles explications ne sont pas invoquées lorsque nous parlons de croyances vraies et justifiées, mais seulement quand la rationalité semble s’effondrer. Un espace pour les explications psychologiques est alors ouvert. Comme si il y avait une association entre l’irrationnel et le social, mais non entre le rationnel et le social.
D’un point de vue classique, la science est le summum de la raison. Elle est objective et impartiale, indifférente face à nos peurs ou nos fantaisies. Lorsqu’il s’agit du contenu de la science, la nature a le dernier mot. Les influences sociales, politiques et idéologiques sur la science sont anathèmes. Lorsqu’on écrit des manuels scientifiques, comme en d’autres occasions, les influences sociales sur le développement des théories scientifiques peut être ignoré en toute quiétude, tout comme dans le cas de nos croyances communes sur le monde. Pour sûr, une histoire pourrait être racontée sur la manière dont les scientifiques ont concentré leurs efforts pour acquérir telle ou telle connaissance, qui l’a publiée en premier, qui a convaincu qui, etc.. Mais les détails de cette histoire ne font aucune différence : une histoire alternative de la science aurait ultimement obtenu les mêmes résultats.
En conséquence, et spécialement dans les sciences naturelles, les étudiants apprennent les théories scientifiques comme si elles étaient apparues depuis une sorte de paradis platonicien : les aléas de l’histoire scientifique, les faux départs, les mauvais tournants et les culs-de-sac, les oppositions infinies entre des points de vue rivaux, les pionniers d’idées scientifiques… tout ceci est rendu invisible.
Pendant longtemps, les philosophes des sciences ont également isolé la science du monde social. Hans Reichenbach, l’un des principaux représentants du positivisme logique, nous a enseigné de séparer strictement le contexte d’une découverte du contexte de sa justification. Le premier a à voir avec l’histoire de la conception d’une hypothèse scientifique, et est de peu d’intérêt pour les philosophes qui essayent de comprendre la logique scientifique. Les philosophes des sciences devraient dès lors ne s’intéresser qu’à la manière dont une hypothèse scientifique, une fois apparue sur scène, a été corrélée aux observations, à sa cohérence interne, à sa falsifiabilité, etc..
Comme nous l’avons vu dans la première partie, les scientifiques et les premiers philosophes des sciences ont adopté une vision idéalisée de la science, qui se concentre sur les succès de celle-ci, et dans laquelle il n’y a pas de place pour les influences sociales ou pour aucun des acteurs impliqués dans la production scientifique. Tout ceci est balayé sous le tapis. Mais le fait que le but final de la science soit d’éliminer les influences sociales n’implique pas que les facteurs sociaux n’aient pas de rôle important à jouer dans le processus. La science après tout n’est jamais que l’effort concerté d’humbles (parfois pas tant que ça) cerveaux humains. Et aucun de ces derniers n’a été spécifiquement conçu pour révéler les mystères du monde.
Ces dernières décennies, la science a été ramenée sur terre à nouveau par la sociologie, les sciences cognitives, la psychologie évolutionniste et l’histoire. Malheureusement, l’opposition entre le rationnel et le social assaille toujours l’étude scientifique de la science elle-même. Le contre coup face à la conception traditionnelle de la science, mise en avant par les tenants du positivisme logique et leurs héritiers intellectuels, a envoyé le pendule dans la direction opposée. Toujours envoutés par l’opposition entre rationnel et social que nous avons vue dans la première partie, beaucoup de ceux qui entendent étudier la science elle même ont supposé qu’au fur et à mesure qu’ils allaient ramener la science sur terre, ses prétentions allaient commencer à se déliter.
La réalité cependant, c’est que toutes les croyances, les vraies et les fausses, ou les scientifiques et les pseudoscientifiques, ont une cause induisant des facteurs cognitifs et sociaux. Si nous voulons savoir comment les gens se mettent à croire des choses, mêmes des choses simples et évidentes comme le fait que les dauphins soient des mammifères, ont besoin d’explications. De la même façon, si nous voulons savoir comment les scientifiques sont arrivés à découvrir toutes sortes de choses sur le monde, nous avons besoin de savoir quelle sorte de gens sont les scientifiques, quelles sont leurs stratégies cognitives, quelle est l’organisation sociale de la science, et comment les hypothèses sont testées et évaluées au sein de la communauté scientifique.
L’étude de ces aspects cognitifs et sociaux de la science a été retardée du fait de la croyance largement répandue selon laquelle une telle étude pourrait compromettre les fondements épistémiques de la science. A cause de notre habitude de dresser les explications rationnelles et sociales les unes contre les autres, nous avons supposé que l’intrusion de la sociologie et de la psychologie dans la citadelle de la science allait saper ses fondations.
Au cœur de cette opposition réside une conception individualiste de la raison partagée par les deux camps des science wars. La notion selon laquelle le social contaminerait le rationnel, à laquelle même les constructivistes sociaux semblent souscrire, a plus à voir avec le positivisme logique que ses tenants ne voudraient bien l’admettre. Durant les science wars, les sociologues radicaux des années 90 ont été égarés par les exactes mêmes intuitions qui avaient rendu les positivistes logiques imperméables aux explications sociales tout en arrivant à des conclusions inverses. Comme l’a noté le philosophe David Hull :
« Parce que la science ne disposait pas des caractéristiques idéales que lui prêtaient les positivistes logiques, les affirmations faites par les scientifiques n’avaient pas plus de garantie que celles des magiciens, des guérisseurs par la foi, ou des politiciens. »
Chaque camp avait faux. La simple opposition entre explications rationnelles et socio-psychologiques va à l’encontre même d’une approche naturaliste. Les connaissances scientifiques ne sont pas générées spontanément depuis le néant, elles émanent d’être humains. Si nos théories scientifiques reflètent le monde réel en dehors de nous, cela doit avoir quelque chose à voir avec nos capacités de perception et nos opérations cognitives, avec les outils technologiques à notre disposition, et ceci dans un réseau complexe d’interactions sociales. Comment cela pourrait-il en être autrement ?
Les sociologues ont raison de dire que la science est profondément un produit social, et que toute connaissance scientifique est en cela « socialement construite ». Aucun individu solitaire déambulant sur une île déserte, aussi brillant soit-il, ne pourrait être capable de redécouvrir la moindre des réalités actuellement connues sur notre univers. Bien que la science aie connu quelques génies solitaires ayant travaillé dans une certaine isolation de leurs pairs, ils étaient toujours engagés dans une entreprise collective dans la mesure où ils construisaient un savoir redevable de leurs nombreux prédécesseurs.
Le fait que la science soit profondément une entreprise sociale et que le consensus scientifique soit atteint par la formation de coalitions et de compétition ne devrait pas nous surprendre. La question est de savoir quelle est l’organisation sociale de la science et si celle-ci lui donne accès à ses aspirations épistémiques. Les scientifiques sont des êtres humains en chair et en os. Si les scientifiques ont réussi collectivement à trouver des vérités significatives sur l’univers alors que d’autres entreprises ont échoué en cela, cela doit avoir quelque chose à voir avec les dynamiques sociales particulières de la science.
Beaucoup de scientifiques croient qu’être objectif et impartial représente des vertus cardinales de la science, et que les biais et la partialité ne sont pas appropriés au travail scientifique. Bien que la culture scientifique encourage ces vertus, elles ne sont absolument pas nécessaires au succès de la science. En effet, certains biais dans telle ou telle direction pourraient même faciliter le progrès scientifique.
Le fait qu’un scientifique soit biaisé n’est pas un problème, pas plus qu’il soit émotionnellement attaché à une hypothèse particulière. L’organisation sociale de la science assure que ces biais soient balancés par d’autres, qui penchent eux, dans d’autres directions. Un exemple de cela est la réorientation de la recherche médicale résultant des critiques épistémologiques féministes : il est de mieux en mieux reconnu qu’en effet, il n’est pas possible de conduire des tests pharmaceutiques sur des populations de référence essentiellement constituées d’hommes blancs d’âge moyen et de supposer que ces résultats puissent être simplement extrapolés à d’autres populations humaines moins homogènes. Hull dit à nouveau :
« L’objectivité qui compte en science n’est pas celle qui caractérise en premier lieu les scientifiques eux-mêmes en tant qu’individus, mais celle des communautés scientifiques. Les scientifiques réfutent rarement leurs propres hypothèses, tout particulièrement si elles sont passées à la postérité, mais ce n’est pas un problème. Leurs collègues seront, eux, très contents de pouvoir tester sévèrement ces hypothèses ».
Le désir de gloire et de succès est souvent vu comme indigne d’un vrai scientifique. Le but de la science est la vérité pour elle même. Bien que de telles motivations puissent effectivement miner un travail scientifique, il n’y a pas de raison significative de croire qu’elles pourraient interdire des découvertes importantes. Même le dépit, la jalousie, et le désir d’humilier un rival peut aboutir à d’excellents travaux scientifiques si les parties prenantes savent qu’elles doivent se soumettre à certaines règles dont la violation entraînera l’exclusion de la compétition.
Dans bien des cas, les influences sociales ne sont aucunement une entrave aux ambitions épistémiques de la science, mais plutôt des facilitateurs de progrès scientifiques. La science opère un contrôle sur certaines des motivations les plus élémentaires des comportements humains au service de la vérité en s’assurant que la confrontation des intérêts individuels et autres biais des scientifiques s’alignent avec le progrès épistémique.
Darwin pourrait bien avoir eu raison dès le départ au sujet de l’ascendance commune, que sa théorie n’aurait pas vu le jour aussi aisément si cela n’avait pas été de paire avec d’infatigables efforts à la recherche d’alliés à engager dans la cause et de négociations avec ses critiques. Tous les partis impliqués dans la dispute essayaient de rallier la nature elle même à leur cause, mais Darwin, évidemment, avait un avantage : la nature était effectivement avec lui depuis le début. Avec l’accumulation de preuves sur le long terme et le flétrissement des factions opposées dans les disputes, les influences sociales sur la science seront filtrées, et à juste titre.
Référence :
[1] Boudry, M., Pigliucci, M., 2018. Chapter 13 Vindicating Science-By Bringing It Down In Rutten, K., Blancke, S., Soetaert, R., (Eds) Perspectives on Science and Culture. pp. 243-258. Purdue University Press. Doi: 10.2307/j.ctt2204rxr.17
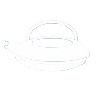


[…] https://theierecosmique.com/2019/07/22/deconstruire-la-science/ […]
J’aimeJ’aime