J’aimerais revenir très rapidement sur ce point (sans aborder dans ce billet les sujets connexes, comme le vaccin contre la coqueluche en général) tant il me semble redondant dans les discussions que je peux avoir avec des antivaccinistes de divers degrés. Car la question est pertinente, pour peu qu’on accepte d’entendre la réponse.
En effet, au regard de la concomitance de plusieurs processus à l’issue desquels une observation est faite, il est légitime de se poser la question des variables confondantes. Bon, à la faveur de l’effet google university, beaucoup de personnes croient réinventer l’eau chaude avec cette question, mais il est utile d’y répondre tout de même pour ceux qui souhaiteraient vraiment comprendre.
Le point est le suivant : les antivaccinistes affirment que l’évolution des conditions sanitaires tout au long du XXe siècle explique la disparition des maladies infectieuses. Les preuves scientifiques expliquent que non. Les gens simplement curieux aimeraient comprendre comment mesurer l’effet de l’un ou l’autre processus.
Il convient d’abord de réfuter d’emblée le sophisme / erreur de bonne foi (selon le niveau d’adhésion à l’antivaccinisme de l’interlocuteur) que représente le recours au taux de mortalité pour rendre clairement compte des effets de la vaccination. Car le seul indicateur pertinent du fardeau infectieux dans une population est le taux de morbidité. Il faut en effet préciser que la vaccination n’est pas la seule innovation médicale du XXe siècle, et la prise en charge des malades, parallèlement au développement de la stratégie vaccinale, a grandement concouru à la baisse de la mortalité. Mais le fardeau infectieux peut tout de même être très lourd sans nécessairement conduire au décès des patients : il peut être invalidant à plus ou moins long terme. Clairement, ne pas mourir de la maladie n’est absolument pas un indicateur du fait que l’on n’a pas la maladie. Pour mesurer ce fardeau –la morbidité donc, c’est-à-dire l’état maladif- il convient d’utiliser le bon outil, à savoir donc le nombre de cas détectés dans la population, et non pas le nombre de cas de décès imputables à la maladie sachant que des variables confondantes (les autres innovations médicales) rendent cet indicateur très peu pertinent. S’accrocher aux courbes de mortalité pour mesurer l’effet de la vaccination, c’est un peu comme se balader avec un thermomètre rectal en prétendant ainsi mesurer la vitesse du vent.
Disons ensuite que nous acceptons très exceptionnellement le retournement de la charge de la preuve auquel se livrent ainsi les antivaccinistes. Le meilleur moyen que je connaisse pour tester facilement l’hypothèse hygiénique (appelons là comme ça), est de recourir à des données observationnelles. Ces données observationnelles peuvent proposer le retrait de l’un des deux paramètres dont on cherche à mesurer l’effet à un moment et à un endroit donné : l’hygiène, ou la vaccination.
Évidemment, plus l’échantillon sera important, plus l’observation sera pertinente.
Or, entre autres exemples patents, le deuxième cas s’est effectivement produit à l’échelle d’un pays dans les années 70. C’est l’exemple du Japon, dont le vaccin contre la coqueluche a été abandonné en 1974 pour être réinstauré en 1981. On peut ainsi observer au niveau national l’effet de l’introduction, du retrait, puis de la réintroduction d’un vaccin sur une population moderne dont on suppose que le niveau d’accès à l’hygiène collective et individuelle n’a pas connu de révolution entre 74 et 81, soit la période de retrait du vaccin.
Au Japon, le vaccin contre la coqueluche a été introduit dans les années 40, et a conduit à un recul drastique de la maladie.

Figure 1 Watanabe et Nagai, 2005.
Ce graphique (qui rapporte donc bien le nombre de cas, indicateur pertinent, et non pas le nombre de morts) porte sur la période 1947-1998.
On y observe que jusqu’au début des années 50, le nombre de cas annuels est d’environ 150 / 100 000, avec un pic tous les 4-5 ans. Le vaccin est amélioré deux fois dans les années 50 et 60, accroissant systématiquement l’effet sur le recul de la maladie. En 1970, on passe en dessous de 0,5 cas / 100 000 personnes et par an.
En imaginant que nous ne connaissions alors rien de la vaccination, la chute drastique de la morbidité proportionnellement à l’amélioration de la couverture vaccinale à l’échelle nationale et sur une période de 25 ans et ceci immédiatement après la première introduction vaccinale, incite à émettre l’hypothèse de la cause vaccinale, non ?
Mais ce n’est pas tout. En 1974 et 1975, des effets secondaires rarissimes attribuables au vaccin ont été rapportés (causant le décès de 2 enfants).
Le gouvernement japonais alerté a décidé de suspendre son programme de vaccination contre la coqueluche.
En 1979, l’incidence de la coqueluche (nombre de nouveaux cas par an) était remonté à 11,3 cas / 100 000 personnes.
Durant cette période où la couverture vaccinale est rapidement tombée à moins de 10%, le nombre de cas de coqueluche est passé de 373 en 1974 à plus de 13 000 en 1979. Plus dramatique encore, le nombre de décès causés par la coqueluche est passé de 0 à 41 entre 74 et 79.
L’alerte légitime des japonais, rapidement transformée en antivaccinisme injustifié, leur a tragiquement rappelé la réalité. En 1981, le gouvernement japonais reprend sa stratégie vaccinale contre la coqueluche à l’aide d’un nouveau vaccin, jugé encore plus sûr, mais intrinsèquement moins efficace que sa forme précédente. Néanmoins, dès cette réintroduction, l’incidence de la maladie chute à nouveau en dessous de 0,4 cas / 100 000 personnes, pour avoisiner 0 cas / 100 000 personnes au début des années 2000. Là encore, le Japon n’a pas connu de révolution sanitaire entre 1979 et 1981.
Si l’on considère l’indicateur pertinent, à savoir celui de la morbidité, alors la conclusion devient évidente, car le phénomène se répète à chaque introduction vaccinale. Cet exemple japonais offre cependant l’exemple assez illustratif de l’introduction, retrait et réintroduction du vaccin dans une population tout à fait moderne, sans changement patent dans l’accès à l’hygiène collective et individuelle.
En définitive, toute personne curieuse des sciences de la santé a raison de poser la question des effets attribuables à chaque progrès technique. La démarche scientifique consiste justement à mesurer sérieusement des phénomènes. Il est illégitime en revanche de rejeter ces mesures non seulement sans apporter de contre mesures solides, mais en plus sans rien apporter du tout.
Par ailleurs, beaucoup de personnes ayant recours à l’argument de l’hygiène, aussi infondé soit-il, semblent croire que toutes les pathologies infectieuses sont plus ou moins corrélées au péril fécal, et que l’amélioration progressive de l’hygiène permettra leur éradication. S’il est vrai que l’amélioration des standards sanitaires peut prévenir dans une large mesure certaines infestations parasitaires par exemple, ce n’est pas le cas de toutes les maladies.
Le seul réservoir connu à ce jour de la bactérie responsable de la coqueluche par exemple est l’hôte humain, et sa transmission se fait par voie interpersonnelle aérienne (quand vous toussez). Il est donc illusoire de penser que l’amélioration des standards sanitaires puisse éradiquer une telle maladie, qui n’est aucunement dépendante de ceux-ci.
Tl ; dr (Too Long ; Didn’t Read)
- L’exemple du Japon et de la coqueluche illustre le rôle de la vaccination dans l’éradication des maladies infectieuses indépendamment des hauts standards sanitaires.
Références linkées dans le texte :
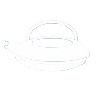
Excellent billet! Concis et précis. La différence entre mortalité et morbidité est fondamentale et doit-être toujours plus diffusée. J’en parle aussi ici moi-même, dans un billet plus généraliste.
http://pigeonducanal.net/2015/07/07/sataniques-et-mythiques-vaccins/
J’aimeJ’aime
Bonjour,
Le graphique que vous présentez précise qu’une forme du vaccin a été remise en place seulement deux mois apres son arrêt (1974.4). Or la coqueluche continue de progresser pendant 6 ans. Vous n’expliquez pas cet épisode dans l’article.
D’autre part, j’ai du mal à comprendre comment la couverture vaccinale peut passer à moins de 10 % en seulement qq années. En fait je viens de comprendre : le vaccins doit être renouvelé tous les 6 ans selon les recommandations. Du coup effectivement ça fait sens: au bout de 7 ans, quasiment plus personne n’est vacciné. Mais vous devriez peut être le préciser qq part.
Ces critiques ne visent qu’à l’amélioration de l’article pour ne pas prêter le flanc à des critiques moins bienveillantes.
J’aimeJ’aime
Salut Johan,
merci beaucoup pour cette relecture critique.
Je me penche à nouveau sur ce billet dès que possible.
en vous souhaitant de bonnes fêtes 🙂
J’aimeJ’aime
La reprise de la vaccination avec le même vaccin DTwP 2 mois après la suspension rend la démonstration totalement fausse.
J’aimeJ’aime
Oui, cela nécessite en effet des éléments complémentaires sur la façon dont la reprise de la vaccination a été mise en oeuvre si on veux comprendre.
Pour le moment j’ai trouvé ceci :
1) la vaccination contre la coqueluche a bien repris au Japon en avril 1975, mais uniquement pour les enfants âgés de 2 ans minimum (au lieu de 3 mois précédemment), d’où une forte baisse du taux de vaccination chez les enfants pendant 2 ans environ, le temps que les nouveaux nés aient atteint les 2 ans. L’article suivant montre en figure 2 le « percentage of eligible children receiving pertussis vaccine in Japan », avec le fameux point bas à 10% en 1976 – même si je ne comprends pas très bien comment il est calculé : comment définit-on un « eligible child » ?
Source : Acellular and Whole-Cell Pertussis Vaccines in Japan, Noble & al., 1987
Lien : http://www.beyondconformity.org.nz/_literature_102885/Pertussis_Noble_JAMA_Japan's_pertussis_vaccination_rates
2) Ce second article montre (Table III) la répartition des cas recensés de coqueluche par tranche d’âge (dans la population totale) en 1977 (sur 5420 cas recensés) : on constate que ce sont les plus jeunes les plus touchés :
– la tranche 0-2 ans en 1977 représente 50% des cas
– la tranche 0-3 ans en 1977 représente 70% des cas
– la tranche 0-4 ans en 1977 représente 80% des cas
source : Japan’s experience in pertussis epidemiology and vaccination in the past thirty years, Kanai 1980, The First Department o f Bacteriology, National Institute of Health, Tokyo
Lien : https://www.jstage.jst.go.jp/article/yoken1952/33/3/33_3_107/_pdf
J’aimeJ’aime
J’ai fait pour ma part une recherche complémentaire a propos de cette réintroduction.
Il semble que l’indication de la réintroduction du DTwP 2 mois après sa suspension soit une approximation des faits.
D’après la source (que je citerai en bas de commentaire bien sur), il semblerait que:
« In 1974–1975, two accidental deaths were reported after the administration of DTwP and, thereafter, DTwP was temporarily discontinued. It was reintroduced for children aged 2 years old and older, or the DT vaccine was used instead of DTwP. »
Il semblerait donc que le vaccin DT ai été réintroduit comme une alternative au DTwP. Bien évidemment, le DT protégeant contre Dyphtérie et Tétanos, il ne concerne pas la coqueluche. Il semblerait donc que le DTwP ai été réintroduit pour les enfants de plus de deux ans, et qu’en plus, il ai été laissé la possibilité d’utiliser le DT en lieu et place du DTwP.
Après, on peut entrer dans le champ des spéculations, mais il ne serait pas inconcevable que si la mort accidentelle de deux patients ai conduit au retrait du DTwP, la population ai pu préférer utiliser uniquement le DT lorsqu’une réintroduction de l’obligation vaccinale a pu leur offrir ce choix.
Source: Vaccine chronicle in Japan, Laboratory of Viral Infection I, Kitasato Institute for Life Sciences, Shirokane 5-9-1, Minato-ku, 108-8641 Tokyo
Lien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3824286/
J’aimeJ’aime
Bonjour,
Je suis le genre de public que vous mentionnez, qui cherche à se faire une idée de la réalité.
Je n’ai pas la prétention d’avoir une démarche scientifique dans cette recherche, mais je m’étonne tout de même de ne trouver dans tous les articles qui défendent les vaccins quasiment que des courbes qui commencent à la date d’introduction du vaccin (et qui montrent une courbe descendante). Votre article ne fait pas exception.
Quand je fais des recherches un peu plus larges et que j’essaie de trouver des courbes prenant en compte les données précédant l’introduction du vaccin. J’observe de façon quasi systématique que la courbe descendait déjà avec une pente similaire AVANT l’introduction du vaccin… Et ça me laisse perplexe.
J’aimeJ’aime
Bonjour Nicolas,
et merci d’avoir pris le temps de commenter 🙂
je vous invite à jeter un oeil à cette traduction réalisée par mes soins, qui présente plusieurs courbes telles que vous souhaitez en voir, et les décrit et explicite :
https://theierecosmique.com/2015/09/28/trad-les-courbes-qui-revelent-tout-sur-lefficacite-des-vaccins/
J’aimeJ’aime
C’est interessant. j’avoue qu’en general les anathemes des vaccinalistes me laissent indifferent. Ils ne procedent que par argument d’autorité. C’est different ici je vais donc creuser. Une chose n’est pas consideré c’est les troubles eventuels qu’on appellera « legers » de la vaccination qui ne sont vraisemblablement rapportes. Ma fille a eu le pentacoq en 1993 et a toujours ete malade… kine respiratoire. Personne n’a mis en relation cet etat de santé avec la vaccination. Puis un jour on nous dit voila un homeopathe qui donne un traitement qui « neutralise » les effets des vaccins. Ca coute rien. L’enfant n’est plus malade. perplexe, nous faisons vacciner le second a minima en 1995. Et la tout se passe bien. Jamais malade. Les 2 enfants sont alles dans la meme creche. Recemment une amie a un jeune enfant en nounou… pentacoq… toujours malade! Alors je veux bien croire a l’efficacité des vaccins. Mais je veux qu’on en mesure les inconvenients et tous les avantages. Sur les avantages on est bassinés. Sur les inconvenients fussent ils modestes (encore qu’un enfant en rhino permanente et kine respiratoire ca ne soit pas rien.
J’aimeJ’aime
intéressant, derrière un vocabulaire scientifique, des erreurs et biais cognitifs!
Démontrer l’efficacité sur un « cas », et inventer un lien de causalité non démontré…
confusion entre interprétation dictée par la croyance et causalité scientifque!
Des situations réelles et documentées font liens de causalité entre vaccination et augmentation du nombre de cas, la vaccination accentuant l’épidémie…
Dommage ce manque de rigueur sur « les vaccins » jette le trouble sur tout vos articles qui pourtant peuvent être pertinents!
J’aimeJ’aime
« Des situations réelles et documentées »
Je lirais volontiers les études que vous évoquez, si vous pouviez les partager ici. Merci d’avance!
J’aimeJ’aime